Faut-il pleurer le départ de Colin Powell ? Dans une administration Bush divisée sur sa ligne de politique étrangère, il était généralement considéré comme la voix de la raison et de la modération, comme le défenseur du multilatéralisme et de la coopération, bref, comme le contrepoids interne sans lequel la diplomatie américaine, dominée par Donald Rumsfeld ou Dick Cheney, aurait pris un tour encore plus unilatéraliste et arrogant. Champion de la tradition réaliste qui court d’Henry Kissinger à George Bush père, favori des démocrates, préféré des Européens, avec qui il tentait d’aplanir les différends et réparer les pots cassés, sa cote de popularité en dehors des cercles néoconservateurs était d’autant plus forte que le contraste avec les faucons unilatéralistes était marqué.
Son remplacement par Condoleezza Rice, qu’on juge déjà sur sa capacité à jouer le même rôle modérateur que Colin Powell est donc logiquement regretté par tous ceux qui préfèrent une Amérique moins guerrière, soucieuse des alliés et de l’ONU.
Le problème, c’est qu’il existe deux faces à la médaille de Colin Powell. Côté pile, le héraut courageux d’une Amérique multilatérale, l’élément modérateur dans une équipe de radicaux. Côté face, le simple exécutant d’une politique qu’il n’influençait pas, l’expert en relations publiques qui a fait passer la pilule d’une politique unilatérale et autiste, impuissant à faire prévaloir ses propres conceptions, accumulant les défaites dossier après dossier.
Dans les livres de Bob Woodward, qui fournissent une mine d’informations sur le fonctionnement de l’administration Bush, Colin Powell désavoue les choix de sa propre équipe. Il pose en sage, laissant entendre qu’il avait prévu les difficultés de l’intervention en Irak, indiquant qu’il a mis en garde le président contre les dangers qui l’accompagnaient et défendu une stratégie différente.
Mais, de deux choses l’une : soit il pensait que cette politique était vraiment déraisonnable et pouvait entraîner des conséquences graves pour la région et pour les Etats-Unis—en ce cas il devait mettre sa démission dans la balance pour influencer la stratégie de l’administration. Soit il n’était pas, au fond, réellement opposé à la ligne dure de ses collègues, et ne peut à présent expliquer qu’il avait tout prévu et ne saurait être tenu pour responsable des dégâts occasionnés.
Une bonne illustration est fournie par son basculement en faveur de l’intervention en Irak. Mi-janvier 2003, Colin Powell constate que le président a pris la décision irrévocable d’en finir avec Saddam Hussein. Il décide aIors de soutenir, lui aussi, l’intervention—trahissant les espoirs de nombre d’observateurs, y compris au département d’Etat—afin de prendre, selon ses défenseurs, le train en marche pour l’influencer plutôt que de se cantonner dans une opposition stérile. Seulement il a été bien plus passager que conducteur de ce train, et son impuissance a abouti à une occupation de l’Irak dominé par les idéologues du Pentagone, dont la tâche a été facilitée par la caution de celui qui incarnait aux yeux du monde l’honnêteté, l’ouverture, le dialogue.
Peut-être Colin Powell a-t-il personnellement pesé sur certains dossiers. Il a convaincu George W. Bush, par exemple, de poursuivre l’engagement avec la Chine et de passer par l’ONU pour la question irakienne. Mais le nombre de ses défaites est bien plus considérable, de Kyoto (il défendait une initiative américaine de contre-proposition sur le réchauffement climatique) à Guantanamo (il soutenait l’application des accords de Genève), de la Corée du Nord et de l’Iran (il souhaitait conduire une politique conjuguant de vraies incitations aux menaces) jusqu’au Proche-Orient (il suggérait que l’Amérique s’implique pleinement dans son rôle d’arbitre).
Bref, son départ, loin d’être la catastrophe que certains prédisent déjà, pourrait marquer au contraire la fin des illusions pour les partenaires de l’Amérique, à commencer par les Européens. Finies les réunions faussement rassurantes avec un Colin Powell fréquentable, attentif et nuancé—mais sans réelle influence. Sortis de cette ambiguïté, les alliés transatlantiques pourraient finalement apprécier une Condoleezza Rice certes plus proche de Bush, mais pour cette raison même plus succeptibles de prendre des engagements qui ne reposent pas que sur la projection de leurs propres espoirs.


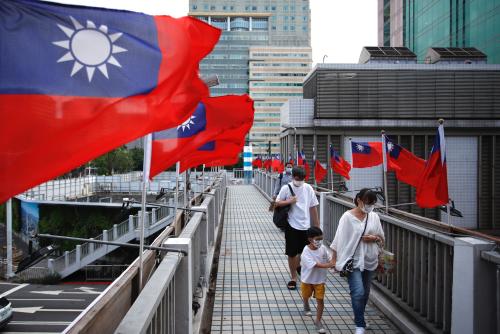
Commentary
Op-edLe testament brouillé de Colin Powell
November 19, 2004